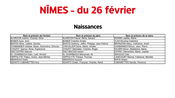Objectif Gard : Personnellement, comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux champignons ?
Jean-Michel Bellanger : C'est sûrement une vie antérieure parce que je suis né avec ça et je ne sais pas d'où ça vient. Dans ma famille, personne ne s'intéressait vraiment aux champignons.
Vous viviez en milieu rural ?
Je suis originaire de Montélimar et on avait une maison avec un petit bois autour. Plutôt périurbain, pas rural. Et quand des champignons poussaient dans les bois, j'étais toujours fasciné. Mais je ne peux pas dire d'où ça vient.
Vous aviez quand même des préconisations, étant enfant, sur les précautions à prendre avec certains, d'éviter de les toucher ou de porter les mains à la bouche après ?
Comme tout le monde, je pense. Mais chez moi, ni mes parents ni mes grands-parents n'étaient "flippés", comme je peux l'entendre parfois à la campagne, en sortie avec des parents, du type "surtout, ne touche pas". Je n'ai pas eu ça. Mais il n'y avait pas de culture de la consommation de champignons dans ma famille.
"Je suis venu apporter l'expertise champignons dans un laboratoire qui s'intéresse à l'écologie"
Depuis combien d'années planchez-vous sur le sujet ?
D'aussi loin que je me souvienne, je devais avoir 5-6 ans. J'en ai 54 aujourd'hui...
Et de façon professionnelle ?
Professionnellement, en France, c'est compliqué car il n'y a pas de formation professionnelle à la mycologie. Les seuls professionnels des champignons, en théorie, sont les pharmaciens, qui sont censés dire si on peut manger les champignons qu'on leur amène ou pas. La plupart des pharmaciens, il faut reconnaître que ça les intéresse très peu. Les quelques-uns qui s'y intéressent et sont compétents, on les connaît bien, ce sont aussi des mycologues qui, par ailleurs, travaillent aussi dans les associations de mycologues, etc. Moi, j'en suis venu de façon très indirecte au laboratoire de recherches où je suis aujourd'hui. J'ai dû passer par une formation en biologie et génétique, pour finalement avoir l'opportunité de venir dans ce laboratoire, qui est un labo d'écologie. Je suis venu apporter l'expertise champignons dans un laboratoire qui s'intéresse à l'écologie.
Il n'y avait pas du tout de réflexion sur les champignons au sein du centre ?
Si, dans l'équipe où je suis, il y avait Marc-André Selmosse, que tout le monde connaît bien maintenant parce qu'il est au Muséum de Paris et qu'il communique beaucoup sur les champignons. Je suis venu dans son équipe en 2012. Donc il y avait déjà un début d'intérêt pour les champignons, mais en tant que partenaires des arbres dans les éco-systèmes forestiers méditerranéens. J'ai apporté un angle un peu plus champignon, diversité, évolution, etc.
Qu'est-ce que vous avez pu découvir depuis que vous travaillez sur le sujet ?
Je suis chercheur à l'INSERM, qui s'occupe de recherches médicales. A priori, cela n'a pas trop de lien avec l'écologie et les champignons. Mais on m'a laissé venir ici avec l'objectif de trouver des molécules chez les champignons qui puissent éventuellement servir de médicament. C'est un de mes projets que je développe en collaboration avec d'autres équipes de Montpellier et d'ailleurs : je fabrique des extraits de champignons et je fais tester ces extraits à des collaborateurs qui travaillent en virologie, en bactériologie, etc. On cherche - et on trouve assez régulièrement - des molécules présentes dans les extraits de champignons et qui vont avoir un effet antibiotique ou antiviral.
"On trouve, tous les ans, des dizaines voire des centaines de nouveaux champignons à l'échelle mondiale"
Quels autres projets développez-vous dans ce laboratoire tourné vers l'écologie ?
Le second volet concerne la taxonomie, c'est-à-dire la science de la diversité des champignons. En cherchant à démontrer que certaines espèces sont nouvelles pour la science. On a une chance en mycologie, par rapport à la zoologie ou à la botanique par exemple, c'est que les champignons sont très mal connus. On trouve donc, tous les ans, des dizaines voire des centaines de nouveaux champignons à l'échelle mondiale. Ça fait partie de mon job de déterminer si les espèces nouvelles en sont vraiment. Ma spécialité, ce sont les outils de la génétique, que j'ai acquis avant. Le troisième axe de mon travail, c'est de m'insérer dans les projets de l'équipe en écologie. Je suis un peu le référent champignon des écosystèmes forestiers méditerranéens, surtout. Dans le contexte de changement climatique, on assiste à des bouleversements d'assemblage d'arbres, de champignons, de micro-organismes. Et je suis celui qui va dire "c'est telle ou telle espèce".
En matière de champignons, vous ne vous limitez donc pas aux forêts méditerranéennes...
Non, pour le côté taxonomie, parce que j'ai des collaborations dans le monde entier, avec des Européens, mais aussi des Canadiens, Américains.
Avec des champignons que vous n'avez donc jamais croisés ou vus...
Exactement. En fait, c'est un vrai travail de collaboration avec des gens qui connaissent très bien leurs champignons sur le terrain et les ont déjà décrits. Moi, j'apporte une expertise de généticien pour confirmer ou compléter leurs travaux de terrain.
En dehors de "comestible ou pas comestible", les champignons sont-ils classés par vertu ou molécule ?
Absolument. Dès le début, la classification des champignons a été basée sur leur forme. En français, champignon désigne vraiment la fructification, qu'on voit et qu'on peut ramasser à la main. Mais ça, ça ne représente qu'une toute petite partie de la diversité des champignons. La plupart des espèces vivent discrètement dans le sol, on ne les voit jamais. Ce sont des moisissures, si vous voulez, mais ce ne sont pas des champignons au sens commun du terme. La mycologie s'est construite sur la forme des fructifications, mais on s'est rendu compte, notamment avec la génétique, que c'est complétement artificiel. On a donc une classification parallèle, mais très peu utilisée par les gens qui ramassent les champignons, qui est naturelle, reflète l'histoire évolutive, mais n'est pas du tout intuitive. Donc, j'essaye de jongler entre ces deux classifications-là, au moins pour informer la communauté des mycologues sur ce que sont les liens de parenté entre les différents champignons.
"Je pense que l'intérêt du grand public va, maintenant, au-delà de leur comestibilité"
A-t-on une idée de la part de champignons comestibles parmi tous les champignons d'un massif comme celui de l'Aigoual, par exemple ?
C'est un peu difficile. On n'a que des estimations qui ne sont valables, je pense, qu'à l'échelle mondiale. On considère, généralement, qu'un peu moins de 10% des espèces seraient comestibles. "Seraient", parce qu'on pense que beaucoup d'espèces pourraient potentiellement être mangées, mais que pour des raisons culturelles - de manque d'habitude ou qu'elles ne sont pas appréciées régionalement - ne le sont pas. Entre 5 et 7% sont considérés comme toxiques ou mortels. Et tout le reste, l'immense majorité, est juste sans intérêt culinaire. Soit ils sont coriaces, soit ils sont tout petits, soit pas assez charnus. Ils ont une importance écologique, évidemment.
Depuis le livre "La vie secrète des arbres" il y a une dizaine d'années - qui s'intéressait notamment aux relations intimes entre arbres et champignons mais dont une part a été contestée - assistez-vous à un engouement plus grand de la part du grand public sur le rôle des champignons ?
Ce livre-là, et quelques autres des quinze dernières années, ont effectivement marqué le grand public. On commence à sentir ça, nous aussi, dans les manifestations comme les Journées mycologiques, auxquelles on associe souvent des cycles de conférence, qu'on appelle les myco-dialogues. On fait venir des scientifiques et on voit de plus en plus d'intérêt pour ces communications un petit peu plus théoriques. Je pense que l'intérêt du grand public va, maintenant, au-delà de leur comestibilité. C'est peut-être aussi lié au changement climatique, à l'éco-anxiété, etc. On le voit aussi avec les étudiants, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir faire des stages, des tests sur les champignons, etc.
"On découvre beaucoup de choses avec l'ADN (...) qu'on ne soupçonnait pas et qu'on parfois du mal à comprendre encore aujourd'hui"
Sur cette relation entre forêt et champignon, faites-vous encore des découvertes ?
C'est le cœur de ce qu'on fait dans l'équipe de recherches. Mon collègue Franck Richard est véritablement l'expert des mycorhises. Maintenant, quand on analyse quelles sont les associations des êtres vivants dans un éco-système, on le fait avec la génétique. On prend ce qu'on appelle l'ADN environnemental - des échantillons de terre, de bois, etc. - et on extrait tous les ADN présents. Et ce qu'on voit, c'est une diversité vraiment insoupçonnée de champignons. Beaucoup d'espèces de champignons, qu'on ne connaissait pas, vivent apparemment à l'intérieur de tissus, d'arbres et de plantes, sans qu'on sache trop à quoi cela sert. Ils sont endophytes, sans être parasites ni nécessaires à la survie de l'arbre. Mais peut-être qu'ils ont une utilité du même type qu'on a, nous, avec la flore intestinale qui nous aide à digérer. Sans que ce soit nécessaire, mais ça nous aide. Donc, oui, on découvre beaucoup de choses avec l'ADN surtout. Et des choses qu'on ne soupçonnait pas et qu'on a parfois du mal à comprendre encore aujourd'hui.
Vous êtes aux premières loges pour assister au changement climatique. Qu'est-ce que vous constatez comme évolution ?
On regarde vraiment ça de près, et notamment grâce aux relevés qu'on fait aux journées mycologiques du Vigan. La manifestation a lieu depuis 1983, ce qui offre un certain recul, et elle a toujours lieu le deuxième ou le troisième week-end d'octobre. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des espèces qui étaient très fréquentes dans les années 80-90, qu'on ne voit plus. Et d'autres qu'on ne voyait pas et qui arrivent. Et souvent, ce sont des espèces adaptées à la chaleur qu'on voyait au nord de l'Afrique ou au sud de l'Espagne.
"La grosse variabilité d'une année à l'autre, et de région à région, masque un peu les variabilités qui pourraient être dues au changement climatique"
Et cela s'acompagne d'une modification des espèces d'arbres ?
Pas vraiment. Les principaux changements qu'on voit, c'est que les arbres souffrent. Les châtaigniers, en Cévennes, c'est connu depuis longtemps. Mais on commence à voir de la souffrance chez des arbres qui sont pourtant tolérants à la sécheresse comme les chênes verts. Les champignons qui arrivent et qu'on ne voyait pas, probablement qu'ils y étaient déjà mais soit ils ne fructifiaient pas, soit ils fructifiaient plus tôt et on les ratait pour les Journées. Le réchauffement et l'assèchement des sols ont tendance à faire un décalage de poussée d'une à deux semaines, plus tardivement.
Avec le réchauffement, voit-on moins les deux stars que sont les cèpes et les girolles ?
Honnêtement, non. En tout cas, pas de mon expérience. Il faudrait étayer cela avec des faits plus solides. Mais de mon expérience de collecteur pour les Journées mycologiques, les années fluctuent, ce qui a toujours été le cas. La grosse variabilité d'une année à l'autre, et de région à région, masque un peu les variabilités qui pourraient être dues au changement climatique. La sortie qu'il y a eue il y a trois semaines en Dordogne, ils avaient rarement vu cela...