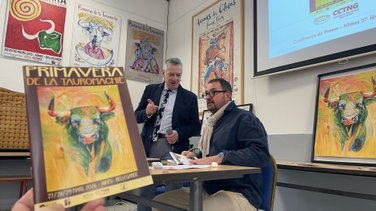Objectif Gard : Les Journées de la paix ont été instituées en 1980 par l'Assemblée générale de l'ONU. Quelle est leur importance aujourd’hui ?
Anne-Cécile Robert : Ces journées sont cruciales car elles nous offrent un moment de réflexion collective pour comprendre comment, à notre échelle, nous pouvons œuvrer en faveur d’une culture de la paix. Il ne s'agit pas seulement de commémorer, mais de s’interroger : comment promouvoir la coexistence pacifique entre les peuples ? Aujourd’hui, plus de 60 pays sont en conflit, affectant en premier lieu les civils, les enfants, les femmes. Il est donc essentiel de se poser des questions sur le rôle des institutions internationales et sur ce que nous, en tant que citoyens, pouvons faire.
Vous avez mentionné l'importance des spécialistes du droit international dans cette réflexion. Pourquoi ce choix ?
Anne-Cécile Robert : Parce que le droit international est le fondement de la régulation des relations entre États. Il définit des règles pour prévenir les conflits et protéger les populations en cas de guerre. Malheureusement, nous constatons un affaiblissement de ces règles, notamment dans des zones comme Gaza ou l’Ukraine. C’est pourquoi j’ai voulu aborder ces questions dans mon livre, Le défi de la paix : les institutions internationales face à la crise, afin d’analyser les failles et de proposer des pistes de réflexion pour refonder l’architecture internationale de la paix.
Selon vous, qui est responsable de maintenir la paix ? L’ONU, les États, les citoyens ?
Anne-Cécile Robert : C’est un effort collectif. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une mobilisation mondiale pour créer des institutions capables d’empêcher de nouvelles catastrophes. Aujourd’hui, il faut la même mobilisation. Les États, les intellectuels, les juristes, les citoyens, les militants… tout le monde a un rôle à jouer. Nous sommes à un tournant historique dangereux. Il est primordial de comprendre ce qui est en jeu, de voir ce qu’il faut préserver, et d’agir pour sauvegarder la paix.
Pourtant, certaines crises semblent insolubles. Que faire face à des dirigeants qui refusent le dialogue ?
Anne-Cécile Robert : Vous avez raison. Quand des dirigeants choisissent la guerre, ils ne s’arrêteront pas d’eux-mêmes. Il faut leur rappeler les règles de paix, parfois même les leur imposer. Cela nécessite une vision politique claire, la volonté d’utiliser les outils disponibles : diplomatie, médiation, conférences internationales, sanctions économiques. La guerre est toujours un échec. On sait quand elle commence, mais jamais quand elle finit. Regardez Poutine : il pensait résoudre rapidement la situation avec l’Ukraine et se retrouve aujourd’hui enlisé.
« Depuis deux décennies, nos présidents ont souvent manqué de courage sur les questions internationales. François Hollande, par exemple, a été catastrophique sur plusieurs dossiers. »
Malgré les sanctions économiques imposées à certains pays, les conflits persistent. Pourquoi cela ne suffit-il pas ?
Anne-Cécile Robert : La diplomatie repose sur deux piliers : le bâton et la carotte. Nous avons beaucoup utilisé le bâton, c’est-à-dire les sanctions, mais souvent sans proposer de solutions politiques attractives. Il manque un vrai projet de paix pour l’après-conflit. Arrêter la guerre est une chose, mais il faut également anticiper la reconstruction politique pour éviter que le conflit ne reprenne. Cela demande de la créativité diplomatique, des plans concrets et du courage.
Quel rôle la France peut-elle jouer dans ce contexte international complexe ?
Anne-Cécile Robert : La France a un rôle majeur à jouer, non seulement en raison de sa puissance militaire et économique, mais aussi grâce à son histoire politique. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, puissance nucléaire, et héritière d’une tradition d’indépendance diplomatique. La France peut dialoguer avec tous, créer des ponts. En ce moment, les grandes puissances sont souvent paralysées : la Russie mène la guerre, les États-Unis posent des veto. C’est précisément là que la France doit intervenir, proposer des initiatives courageuses comme la reconnaissance de l’État de Palestine, et entraîner d’autres pays à sa suite.

Pensez-vous qu’Emmanuel Macron et ses prédécesseurs ont été à la hauteur de cette mission ?
Anne-Cécile Robert : Malheureusement, non. Depuis deux décennies, nos présidents ont souvent manqué de courage sur les questions internationales. François Hollande, par exemple, a été catastrophique sur plusieurs dossiers. Emmanuel Macron, avant sa récente initiative sur la Palestine, était très en deçà de ce que la France aurait pu faire. Nous manquons de leaders qui portent haut la voix de la France sur la scène internationale, à l’image de De Gaulle ou Mitterrand, qui n’hésitaient pas à défendre des positions impopulaires mais justes.
Votre livre vise-t-il à sensibiliser uniquement les décideurs politiques ?
Anne-Cécile Robert : Non, il s’adresse aussi au grand public. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur nos dirigeants pour défendre la paix. Les citoyens ont un rôle fondamental à jouer. Ils doivent s’informer, débattre, exiger des comptes à leurs élus. La paix ne se construit pas seulement dans les sommets internationaux ; elle dépend aussi de l’engagement des sociétés civiles.
Organisez-vous des événements pour promouvoir ces idées ?
Anne-Cécile Robert : Oui, nous organisons des conférences et des projections-débats. Ce dimanche, par exemple, nous présenterons un documentaire sur le partage de la Palestine, suivi d’un échange avec le public. L’objectif est d’ouvrir le dialogue, de partager des points de vue différents et de réfléchir ensemble à des solutions. La paix se construit par la parole, l’écoute et la compréhension mutuelle.
Avez-vous eu des retours de la part de responsables politiques ou d’institutions internationales ?
Anne-Cécile Robert : Oui, mon livre a circulé parmi des députés, des sénateurs, même au sein de l’ONU. Certains m’ont fait part de leurs réflexions, mais il reste beaucoup à faire pour transformer ces idées en actions concrètes. Ce qui est certain, c’est qu’il comble un vide : il n’y avait pas d’ouvrage de synthèse accessible sur le fonctionnement des institutions internationales et leur rôle dans la préservation de la paix.
Un ciné-débat à Saint-Jean-du-Gard
Samedi 21 septembre à partir de 17h à la salle Stevenson de Saint-Jean-du-Gard, place au cinéma avec la projection de « Route 181 », un documentaire fleuve de 4h30 réalisé en 2003 par l’Israélien Eyal Sivan et le Palestinien Michel Khleifi.