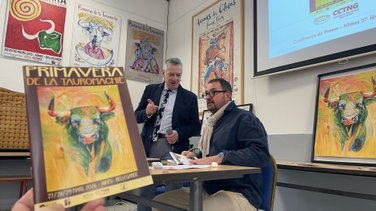Un étalage de matériels plus impressionnants les uns que les autres, des uniformes aux tons variés et un mélange de rappel des règles et des procédures. Au grand dam des cyclistes, qui en avaient programmé l'ascension, le sommet du mont Bouquet était bloqué, ce jeudi matin, par des CCFI (camions de citerne feux de forêt), des véhicules Dangel des DFCI, des équipements du génie, des drones de surveillance et, même, un hélicoptère bombardier d'eau. Un étalage des grands moyens nécessaires à la lutte contre les incendies dans le département, auquel il manquait tout de même un acteur de poids : la Sécurité civile, en charge des Canadairs et autres Dash.
Coordinateur "toute l'année", la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a, par la voix de son directeur adjoint, Jean-Emmanuel Bouchut, rappelé les trois arrêtés préfectoraux qui encadrent le feu dans le département. "Depuis 2013, tout feu est interdit, dans le département, a minima du 15 juin au 15 septembre. En 2020, un autre arrêté a mis en place une régulation des travaux interdits en période rouge du risque. Enfin, il y a trois ans, un arrêté a mis en place les fermetures de massifs."

En fonction du niveau de risque et de réglementations parfois différentes, le Gard est découpé en huit zones. "Les statistiques sur 7 ou 8 ans nous montrent que les massifs ne ferment pratiquement jamais en Cévennes", relativise Jean-Emmanuel Bouchut. Gard rhodanien et Petite Camargue concentrent le plus grand nombre de jours de fermeture, avec, respectivement, une moyenne de cinq jours de fermeture et de huit jours de fermeture par an. Mais jusqu'à vingt, en 2022, qui vit aussi des massifs cévenols se fermer.

Fermer les massifs, un acte de prévention pour les services de l'État. Tout comme les obligations légales de débroussaillement (OLD), dont les agents des patrouilles DFCI (défense de la forêt contre l'incendie) s'occupent. Dans le Gard, ces patrouilles mettent, dans un même véhicule, un sapeur-pompier et un agent de l'Office national des forêts. Une spécificité départementale qui a fait ses preuves, selon les principaux intéressés. Pendant l'été, 26 patrouilles se partagent quotidiennement le territoire. "On avait baissé à 20. Mais on est remonté à 26 après l'été 2022", explique Fabien Brochiero, responsable du pôle DFCI pour l'ONF sur le Gard, la Lozère et l'Hérault. Au début juillet 2022, l'incendie de Bordezac s'est chargé de remettre les priorités dans le bon ordre... D'autres patrouilles plus légères, d'un seul agent ONF ou de police renforcée, quadrillent aussi le territoire. Pour "intervenir sur des lieux à forte fréquentation".

Le bien nommé Fabrice Voland, responsable de la cellule drones, a présenté les nouveaux matériels dont le département a pu s'équiper, notamment à l'époque où les fonds verts étaient encore dotés par l'État. Des matériels de prise d'information, "télépilotés par dix pilotes, tous sapeurs-pompiers", pouvant apporter "de l'imagerie visible et de l'imagerie thermique". Au centre de ces bijoux de technologie, l'un est bien plus massif que les autres. "En 2025, on lance une phase expérimentale sur des drones de levage, qui peuvent porter jusqu'à 35 ou 45 kilos." Des objets volants qui pourraient, au cours d'un incendie, acheminer du petit matériel sur le théâtre d'opération, voire tout simplement des bouteilles d'eau à des sapeurs-pompiers au contact des flammes.

De l'eau, c'est ce qui est chargé de sauver la vie des pompiers, qui seraient pris dans les flammes et cloîtres dans leur camion-citerne, qui doit se transformer en lieu refuge. Avec 9 000 litres embarqués, le camion doit garder de quoi se protéger, en s'arrosant, si les flammes viennent le lécher, atteignant une température de 1 000 à 1 200 °C. "En 2022, cet équipement a sauvé des équipages chez nous", explique le chef de groupement du SDIS, Éric Agrinier.

Pour ne pas devoir affronter des incendies vastes et incontrôlables, les services en charge de la lutte essaient de détecter, le plus tôt possible, toute fumée ou départ de flammes. Désormais, huit caméras assurent une vision plus fine, de jour comme de nuit. Originaire du secteur de la Défense, la société de Milhaud, Exavision, a développé des caméras qui permettent de couvrir environ 700 km² de territoire (soit 15 km de rayon) afin d'équiper les vigies du département. Caméra de vision et caméra thermique sont complétées par une intelligence artificielle "pour une vision automatisée", défend Marc Brun, directeur général de l'entreprise. L'appareil est efficace de jour comme de nuit. Sur la tour de guet du mont Bouquet, deux caméras Exavision couvrent les 360° du panorama. Chacune coûte 800 000 €, dont 600 000 € financés par l'État.

Ce ne sont pas les caméras, mais la tour de guet, qui a rendu le maire de Brouzet-lès-Alès, Mathieu Testard, revendicatif, au moment de souhaiter la bienvenue à tous les services présents. À côté d'une chapelle dont sa municipalité a dû traiter l'effondrement, il s'est inquiété de l'absence de rénovation de la tour de guet, en faisant "un appel au SDIS". Directeur adjoint du SDIS, le colonel Thierry Carret a glissé : "Je crois que la tour est communale." Un argument dont le sourire cachait mal la mauvaise foi. Car si la tour est située sur une commune, les services qu'elle rend dépassent largement son périmètre...

En fin de matinée, les services de l'État ont rappelé, avec 90 % des incendies d'origine humaine, que "l'incendie est l'affaire de tout le monde", alors que débute un été "qui ressemble à 2003". Pour les pompiers, cette année-là rime, certes, avec la canicule, mais aussi avec des incendies massifs dans le Var. Et de lutte contre les flammes, au soleil avec des kilos de matériel, alors que le thermomètre affiche près de 40° à l'ombre. "Tous les après-midis, on a 160 pompiers sur le terrain, poursuit Thierry Carret. Et on reste comme ça, jusqu'aux pluies conséquentes qui nous disent que la saison est finie. Ce qui intervient plutôt en novembre, désormais".

Alors que deux incendies ont déjà été arrêtés dans les sept derniers jours dans le département - à Saint-Gilles et Roquemaure - sept départs de feu ont ravagé le massif forestier de Bizanet, dans l'Aude. Si les acteurs gardois de la lutte contre les incendies ont insisté, ce mercredi, sur la prévention - "un euro de prévention permet d'économiser 7 €", selon le préfet du Gard - Jérôme Bonet, est aussi revenu sur l'affaire audoise. Alors que l'incendie relève de l'imprudence stupide et non d'une intentionnalité, l'auteur présumé des faits est en détention provisoire depuis mardi. Signe d'un durcissement en la matière à l'encontre des auteurs d'un départ de feu. Et le préfet du Gard a dit ne pas douter de la détermination des deux procureurs des tribunaux de Nîmes et d'Alès sur ces sujets.

Et puis, Thierry Carret prévient : si l'obligation légale de débroussaillement n'a pas été respectée par un propriétaire, "est-ce que j'engage la vie d'un pompier pour défendre une habitation qui n'a pas été débroussaillée ?" L'absence de réponse à la question était déjà une réponse en soi...