
À travers une sélection de plus de 80 œuvres, cet accrochage thématique aborde le drapé comme un outil pour transmettre comme un outil pour transmettre des émotions, un savoir-faire technique et un témoin des époques passées.
En France, la définition moderne du mot « drapé » apparaît à la fin du XVIIe siècle avec le mot de « draperiel » qui signifie en termes de peinture, la représentation des « estoffes et des habits » de l'Académie française en 1694.
Le drapé est donc une représentation dessinée, sculptée ou peinte des vêtements et autres textiles. Il peut aussi désigner des pans de tissu libres comme les rideaux, les draps ou le linge de table ainsi que tous mouvements que forment leurs plis.

Témoin d’une société, d’un temps mais également marqueur social, la représentation du textile permet de retracer l’histoire des modes et des traditions. Dans des mises en scènes succinctes ou théâtralisées à outrance, les artistes racontent l’Histoire et content des histoires.
La souplesse des tissus et l'infinité des textures aux couleurs chatoyantes démontrent le talent des artistes, l'illusion est parfaite ou presque.
Dans cette exposition le musée vous propose un parcours sensoriel à proximité des œuvres d’art : des matières délicates à toucher et des parfums enivrants à humer pour l’art du drapé dans tous les sens.
Projet réalisé avec Christèle Jacquemin, les élèves de 4e du collège Capouchiné et le lycée Saint Vincent de Paul. Un livret de visite est à votre disposition.

Peintures et sculptures permettent d'étudier le vêtement : l'évolution des costumes des teintes et des matières. Cependant, comme dans les autres disciplines, la cérémonie l'éphémère et le luxe sont toujours plus représentés.
Le décalage entre vêtements quotidiens et d'apparat est évident notamment à la période moderne (fin du XVe - fin du XVIIIe siècle). Les vêtements aristocratiques sont donc évidemment mieux connus que ceux des autres catégories sociales inférieures, en outre, le vêtement féminin est bien plus illustre que le masculin. En effet, en particulier au XIXe siècle, une floraison de portraits féminins invite à observer l'évolution rapide de la mode.
Seules les écoles du Nord se distinguent et laissent, dès le XVIIe siècle, une part importante aux scènes de genre de milieux modestes et réalisent des portraits de personnes anodines.

Cette histoire du vêtement à travers les arts plastiques est intéressante mais lacunaire et biaisée. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que l'ensemble des couches sociales soit représenté. Le Réalisme, l'Impressionnisme et les autres courants de la fin du XIXe et début du XXe siècle brisent le carcan académique et mettent en valeur les travailleur, les scènes sociales, ouvrières et paysannes se répandent.
Que ce soit sur un personnage ou dans un espace intérieur, le drapé est un élément central, costume, nappe, rideau, tapisserie, se déploient sur les toiles. La finesse des broderies, les jeux d'ombre et de lumière des plis, l'aspect soyeux et chatoyant des tissus démontrent l'habileté des peintres. Au XVIIe siècle, la nature morte devient un genre à part entière dans lequel les artistes dévoilent des prouesses techniques.
La présence des tissus, où leur emplacement n'a parfois pas de sens logique, elle sert plus à prouver talent et dextérité qu'à servir le propos.

Jusqu'à la Renaissance, le métier de peintre ou sculpteur s'apprend dans les ateliers, auprès de maîtres plus âgés. En 1648, pour échapper au système des corporations qu'il juge royale de peinture et de sculpture. La formation des artistes est dès lors conditionnée par cette institution très organisée : les élèves apprennent la rhétorique, la poésie, l'histoire mais aussi la perspective la géométrie et l’anatomie. La copie de sont au cœur de cette formation.
L'analyse et la connaissance du corps sont considérées dès le Quattrocento comme indispensables pour représenter des scènes de personnages, scène d'histoire ou de genre. À la même période, le dessin devient un support privilégié pour l'enseignement. Vasari, dans ses « Vies des plus grands peintres, sculpteurs et architectes, édité en 1550, explique que le dessin est « père de nos trois arts ».

Le dessin d'après modèle vivant est privilégié par les artistes, l'étude de nu devient rapidement un genre en soi. Les artistes croquent dans un premier temps les modèles nus, pour les draper dans un second temps.
Le drapé est employé fréquemment par les peintres et sculpteurs pour accentuer le mouvement du corps. Le choix de la matière, l'agencement des plis, la forme générale sont utilisés pour renforcer le propos : grandeur, passion, souffrance... Mais le drapé se décrit aussi par ses couleurs, celles-ci fonctionnent en grande partie par convention ou idéologie.
La couleur des tissus dans les œuvres en particulier du « grand genre » (scène religieuse, mythologique ou historique) n'est pas anodine. Elle donne des indications sur le personnage : son identité, son statut ou même le rôle qu'il joue. Ces notions évoluent avec le temps et sont liées à la recherche sur les procédés de teintures d'étoffes mais aussi à des changements sociaux.

Le bleu, par exemple, décrié à l'époque de la Rome Antique est, dès le XIIe et le XIIIe siècles, réhabilité. Il devient la couleur du vêtement de la Vierge Marie puis la couleur des rois.
Le tissu peut amplifier les gestes des personnages par son envergure et le travail de ses plis. Par le jeu de la lumière et de l'ombre, du volume et de la matière, l'artiste parvient à donner l'illusion de mouvement à une œuvre immobile par nature.
Le drapé donne vie aux éléments invisibles comme l'air ; le vent s'engouffre, représenté par des tissus qui se gonflent et donnent vie à la figure. Le drapé soulevé, se déploie et suggère une action une direction ou la vitesse de déplacement d'un personnage.
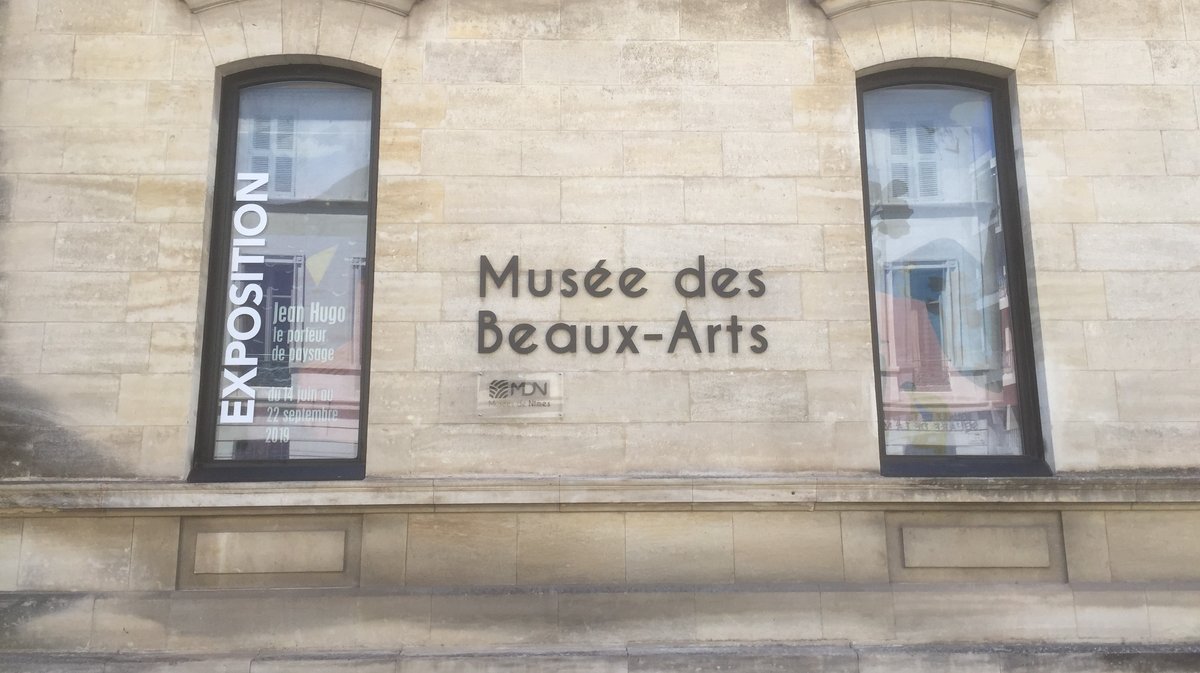
Le mouvement du tissu peut aussi souligner l'expression des sentiments. Impression de légèreté par un voile transparent et flottant ou traduction d'une tension dramatique, l'artiste cherche à renforcer son propos. Un drapé froissé peut évoquer, un trouble, un tombé lourd et régulier de la grandeur, un drape tourbillonnant une passion ou encore le caractère fugace du temps.
Les drapés, leurs couleurs, leurs agencements, permettent aux artistes de mettre en scène leurs propos. Très codifiés notamment en ce qui concerne les coloris, ils permettent à reconnaissance de personnages et la compréhension de l'œuvre. Ils servent aussi à accentuer les émotions comme la joie ou le désespoir.
À la Renaissance, les artistes, fascinés par l'Antiquité, observent et admirent ce fameux drapé des sculptures grecques ou romaines ; il devient un objet d'étude majeur. Associé au corps, il est étudié dans les ateliers et les académies : le tombé, les plis, le rendu des textures donnent lieu à de nombreuses esquisses, croquis et dessins préparatoires. La représentation des tissus est devenue un témoignage important des costumes et modes des siècles passés. De très nombreux portraits ou scènes de genre sont des indicateurs des goûts et mœurs d'une époque.
Le Pass Textile est en vente à l’Office du tourisme et dans les quatre musées municipaux (Museum d'Histoire naturelle, Musée du Vieux Nîmes, Musée des beaux-arts, Musée des Cultures Taurines) au tarif unique de 10 euros.
Il est également en vente en ligne sur le site internet de l'Office du Tourisme. Les détenteurs du Pass auront accès une fois à l’ensemble des quatre musées municipaux et à la chapelle des Jésuites. Le visiteur ne souhaitant pas se doter du Pass pourra également accéder à l’ensemble des musées avec les droits d’entrées habituels (tarif plein, tarif réduit et tarif exo). Le pass donne également droit à un tarif réduit pour la balade sonore urbaine géolocalisée.




























