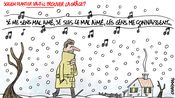{{IMG:1}}
La Cour des comptes, dans son rapport publié ce jeudi 07 juillet 2011, pointe la gestion des forces de sécurité dans les communes françaises et notamment dans le Gard.
Pour rappel, la Cour publie, chaque année, un rapport public annuel et des rapports publics thématiques.
www.objectifgard.com vous propose de découvrir les conclusions de la cour des comptes pour la région Languedoc-Roussillon et Nîmes en particulier :
Face à la montée de la délinquance, les pouvoirs publics ont consacré des moyens croissants, budgétaires, technologiques et humains, aux politiques de sécurité publique.
Les forces de police et de gendarmerie ont ainsi, durant la période 2003-2007 couverte par la loi d’orientation et de programmation (LOPSI) du 29 août 2002, bénéficié d’un renforcement de leurs crédits et de leurs effectifs pour accomplir leurs missions.
Toutefois, les statistiques du ministère de l’intérieur font apparaître que les résultats obtenus dans la lutte contre la délinquance ont été contrastés.
Par ailleurs, en raison de l’objectif de stabilisation des dépenses de l’Etat, les services de la police nationale chargés de la sécurité publique comme les unités de la gendarmerie départementale connaissent désormais un mouvement de réduction de leurs moyens, qui, au terme de l’année 2011, aura déjà effacé les créations d’emplois résultant de la LOPSI.
La Cour des comptes a enquêté auprès des préfectures, des services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique (directions départementales et circonscriptions de sécurité publique), des formations compétentes de la gendarmerie nationale (régions et groupements départementaux) et des procureurs de la République.
Son contrôle s’est aussi exercé sur les services centraux des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
A partir d’un échantillon de 52 villes de toutes tailles dont Nîmes, les chambres régionales des comptes, principalement celles des quatre régions Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon, ont procédé au contrôle des actions des communes et intercommunalités en matière de sécurité publique à travers leur participation aux dispositifs de prévention de la délinquance et, pour celles qui en sont dotées, leurs polices municipales et leurs systèmes de vidéosurveillance.
2002-2010 : une augmentation des effectifs suivie d’une égale diminution
Les forces de police et de gendarmerie ont pu, durant la période 2003-2007 couverte par la loi d’orientation et de programmation (LOPSI) du 29 août 2002, tabler sur un renforcement de leurs crédits et de leurs effectifs.
L’orientation à la baisse de l’évolution des moyens de deux forces, ensuite décidé en vue de stabiliser les dépenses de l’Etat, a commencé à être perceptible en 2009 et surtout en 2010 dans les services de police et les unités de gendarmerie chargés des missions de sécurité publique.
La diminution du total des effectifs n’a pas été uniforme. Certaines régions ont connu en 2009 une baisse non négligeable : Aquitaine (-2,2 %), Lorraine (- 2,9 %), Midi-Pyrénées (- 1,3 %), Nord-Pas-deCalais (- 3,1 %), Ile-de-France (- 1,8 %).
D’autres ont bénéficié d’une augmentation : Rhône-Alpes (1,4 %), Loire (2,2 %), Languedoc-Roussillon (1,5 %).
Le poids de la police municipale
La présence des policiers municipaux sur le territoire national est très différenciée entre les zones les plus urbanisées et les espaces ruraux. Seulement 30 % des polices municipales sont implantées dans les communes situées en zone de compétence de la police nationale, mais elles y concentrent près de 60 % des effectifs de policiers municipaux.
La répartition des effectifs est inégale aussi au plan géographique. Plus de la moitié sont concentrés dans quatre régions : l’Ile-de-France, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La région PACA est celle où la densité de policiers municipaux par rapport à la population est la plus conséquente.
La taille moyenne des services de police municipale (38 agents) est beaucoup plus importante que dans les autres régions (11,5 agents).
On y compte en moyenne un ratio de 7,7 policiers municipaux pour dix mille habitants au lieu de 4,8 au niveau
national.
Dans les communes de l’échantillon retenu par les juridictions financières, n’apparaît pas de corrélation entre l’importance ou l’évolution des effectifs des policiers municipaux et celles des effectifs de policiers nationaux affectés en sécurité publique.
Toutefois, dans certaines villes au taux de délinquance élevé, comme Cannes, Aix-en-Provence, Lyon, Saint-Etienne, Sète et Nîmes, on ne peut exclure que la mise en place d’une police municipale aux effectifs conséquents ait été un palliatif à la stagnation ou à l’érosion de ceux de la police nationale.
L’évolution et l’importance variables des dépenses
Les comptes administratifs des collectivités montrent que les dépenses des villes pour la sécurité sont en forte augmentation depuis une dizaine d’années, même si elles sont encore le plus souvent limitées à moins de 5 %
de leur budget total.
Au sein de l’échantillon de l’enquête, elle variait en 2008 de 0,8 % des dépenses totales de Vitry-sur-Seine (1,5 M€) à 7 % de celles de Cannes (25,73 M€). Cette dernière ville a consacré à la sécurité un budget presque deux fois plus important que la ville de Lyon (21,8 M€).
En 2008, pour les autres communes de la région PACA, la part des dépenses de sécurité dans les seules charges de fonctionnement, allait de 3 % à Nice et Aix-enProvence à 4,7 % à La Ciotat (contre 9 % à Cannes).
Dans la région Languedoc-Roussillon, la ville de Nîmes consacrait 3,7 % de son budget de fonctionnement à la sécurité.
L’exploitation des systèmes de vidéosurveillance
Le ministère de l’intérieur, localement les préfets et les DDSP, incitent les maires à doter leurs communes de systèmes de vidéosurveillance de la voie publique, équipés d'un renvoi d'images vers les commissariats, les brigades de gendarmerie ou les centres d’information et de commandement (CIC), qui peuvent alors utiliser les images transférées en temps réel pour améliorer les conditions de leurs interventions opérationnelles.
En septembre 2010, hors Paris et la petite couronne, une centaine de CSU étaient raccordés aux services de la police nationale, ainsi en mesure de visionner en temps réel les images transmises pour leurs besoins opérationnels.
Sauf exception comme à Antibes, les policiers nationaux ne peuvent pas intervenir dans l’exploitation du système de vidéosurveillance, en prenant à distance le contrôle des caméras.
Le dispositif en place à Nîmes est également particulier puisque la police nationale, comme dans d’autres villes, dispose dans son CIC d’un renvoi d’images assuré par le CSU, mais pas le poste de commandement de la police municipale pour des raisons de confidentialité.
Les opérateurs du CSU appellent le CIC pour tout délit en train de se commettre. Ils avertissent néanmoins la police municipale lorsqu’un fait relève directement de sa compétence.
Les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale sont particulièrement intéressés par le développement de la vidéosurveillance de la voie publique qui peut les aider à piloter l’action des unités chargées des opérations judiciaires, par exemple pour la répression du trafic de stupéfiants.
Les caméras permettent la filature de suspects ou d’auteurs d’infractions en flagrant délit ou en fuite. Il est parfois possible de suivre l’itinéraire d’un délinquant depuis la commission des faits jusqu’à son arrestation.
La vidéosurveillance est aussi employée en soutien aux opérations de service d’ordre ou de maintien de l’ordre. Elle fournit un important appui opérationnel pour l’encadrement des manifestations et rassemblements publics de grande ampleur. Elle permet aux responsables de police nationale d’avoir une vision d’ensemble pour, par exemple, traiter les incidents éventuels en queue de cortèges, en complément des informations transmises par radio.
Enfin, la vidéosurveillance est devenue, pour les services d’enquête de la police nationale, un outil d’investigation judiciaire d’usage fréquent.
A Nîmes, depuis la mise en place en 2003 d’un système de vidéosurveillance qui comportait 74 caméras en 2008, le nombre des interpellations réalisées sur intervention du CSU est passé de 4 à 163.
Répartition des effectifs de policiers de la DCSP dans le Gard (Source : ministère de l’intérieur)
Nîmes
Nbre d’hab. par policier au 01/01/09 : 376
Nbre de faits pour 1000 hab. en 2008 : 113,64
Beaucaire
Nbre d’hab. par policier au 01/01/09 : 317
Nbre de faits pour 1000 hab. en 2008 : 93,76
Alès
Nbre d’hab. par policier au 01/01/09 : 491
Nbre de faits pour 1000 hab. en 2008 : 92,33